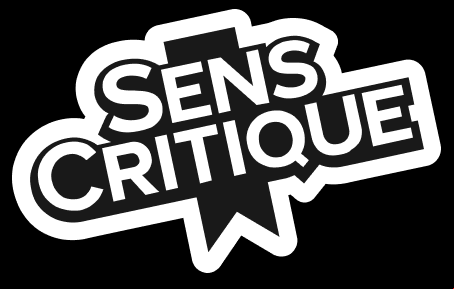Ce film de Mankiewicz, l’un de ses derniers, est très différent de ce qu’il aurait dû être. Dans son ouvrage consacré à l’auteur de La Comtesse aux pieds nus et de Cléopâtre, Pascal Mérigeau explique que l’idée du réalisateur n’était pas de filmer une nouvelle «comédie de salon» mais de «tenter de construire une histoire comme cela n’avait jamais été fait auparavant à l’écran». L’action de cette histoire policière à la Agatha Christie, adaptée d’un roman de Thomas Sterling, Le tricheur de Venise, devait être interrompue par les producteurs du film, les distributeurs et les exploitants de salles du film dont les interventions étaient censées modifier le scénario et l’évolution de l’intrigue en fonction de critères moraux et commerciaux, l’idée étant de faire en quelque sorte un film qui raconterait sa propre autocensure. Malheureusement, Mankiewicz, sous la pression des mêmes producteurs qu’il pensait mettre en scène, dut renoncer à cette idée beaucoup trop audacieuse dont il ne reste que quelques bribes dans la dernière partie du film où Cecil Fox commente post mortem un dénouement ironique qu’il n’avait pas prévu. Ce qui reste aujourd’hui est un film brillamment dialogué, interprété et photographié mais qui souffre d’une certaine longueur et d’un dénouement inattendu mais un peu trop laborieusement fabriqué, surtout si l’on fait la comparaison avec un autre huis-clos policier sur le thème de la manipulation et des rapports de classe*, Le limier*, l’ultime chef-d’oeuvre que Mankiewicz tournera cinq ans plus tard.