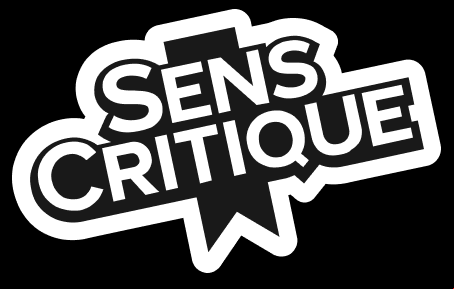Sophie Benard, critique littéraire au Monde des livres (essais) et “philosophe de formation”, nous explique la 4e, a tous les attributs de quelqu’un de sérieux. Elle propose un essai de vulgarisation d’un sous-champ des sciences sociales, les fan studies, regroupant – l’avantage des anglicismes, c’est qu’ils sont signifiants – les études souvent sociologiques des communautés de fans. Mais en l’occurrence, pas n’importe quelles fans, puisque l’autrice entend réhabiliter la figure de la groupie, cumulant plusieurs stigmates sociaux traditionnels : jeunesse, genre féminin, et cette iration éperdue pour un homme inaccessible. Et conformément à la ligne de la maison Les Pérégrines et leur collection “Genre !”, l’autrice de soulever le capot de ce cliché misogyne et de mettre les mains dans le cambouis pour nous en exposer tenants et aboutissants, en prenant en compte sa propre ion pour Ed Sheeran. Pour une philosophe et critique littéraire du Monde, c'est ce qu’on pourrait appeler un faux-pas culturel ; elle exploite justement cette dissonance socio-culturelle.
Et il est vrai qu’à la lire, on se dit que c’est limpide et on regrette de ne pas y avoir pensé plus tôt, y compris et d’autant plus quand on s’est déjà frotté au sujet dans le cadre académique. Je n’ai pas mon exemplaire des Fans des Beatles du sociologue Christian Le Bart (qu’elle cite) sous la main pour vérifier, mais je me souviens qu’il analysait le fan comme un stigmate négatif qu’on pouvait se réapproprier selon plusieurs modalités positives (l’expert, l’archiviste, le collectionneur...) précisément pour s’éloigner, selon ses enquêté•es (enfin surtout ses enquêtés sans e), de la figure-repoussoir de la groupie, aliénée, désintellectualisant sa ion, et, tare féminine ultime, hystérique. C’est la principale force de l’essai, qui est en cela très réussi : Sophie Benard déconstruit cette étiquette de la groupie et en expose tous les soubassements misogynes, pour ensuite retourner le stigmate et montrer ce qu’être groupie veut dire (allez, j’arrête les références sociologiques), quels types d’apprentissages concrets cette activité implique et permet...
On apprend plein de choses, notamment l’origine de la notion. Dans notre imaginaire contemporain, on renvoie l’apparition de la groupie aux Beatles (la fameuse Beatlemania), éventuellement à Elvis un peu plus tôt. Pourtant, dès le XIXe siècle, le pianiste et compositeur Franz Liszt eut un public de jeunes femmes fidèles et déchaînées, tant et si bien que l’écrivain Heinrich Heine inventa le terme “Lisztomania”. Et dès l’Antiquité, les gladiateurs romains avaient leurs groupies... Je ne vais pas faire une recension du bouquin, très riche, mais je dirais que les ages sur les rapports des groupies au désir, un désir performatif, pour soi, désérotisé et au second degré, ainsi que l’analyse de l’ouverture des imaginaires possibles sociaux, politiques et sexuels (en particulier queer) des groupies, souvent des jeunes femmes des classes populaires – celles des CSP+ comme l’autrice investissent d’autres façons d’être fan – m'ont particulièrement intéressé.
Je relève quelques faiblesses d’écriture (les parenthèses ironiques à répétition) et d’analyse sociologique, notamment celle de Bourdieu, qui est au mieux trop légère, au pire incompréhensible (p. 151-152). Enfin l'autrice est philosophe, on la pardonne... En fait, l’entre-deux (trois ?) essai de vulgarisation / analyse universitaire / essai politique m’a un peu déstabilisé. Mais pour un autre lectorat, à commencer par les groupies actuelles ou ées, les incursions par la propre groupietude de l’autrice peut être une force. Dont acte. En dépit de ces réserves, Splendeurs et misères des groupies est un essai solide, intelligent et engagé tout en restant parfaitement compréhensible qu’on ne peut que recommander.
À contre-courant d’un discours médiatique qui s’est appliqué à représenter les fans de One Direction comme “obsessionnelles et hystériques” et à interpréter leur comportement comme “un désir d’intimité hétérosexuelle avec les membres du groupe”, les Larries montrent, par leur intérêt pour la supposée relation amoureuse entre Harry Styles et Louis Tomlinson, que les groupies ne peuvent être réduites à la transposition d’un désir hétérosexuel dans une pararelation à une célébrité. Au contraire, on peut considérer qu’en “construisant un sous-fandom autour de l’imagination d’un ship entre deux membres du groupe”, elles ont “subverti ce cadre hétéronormatif” (p. 136-137)