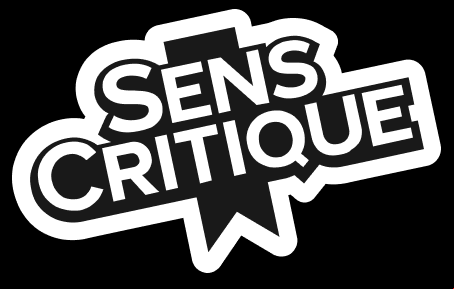Mehdi Maizi écrivait il y a quasi 10 ans (2015 !!!!) un livre qui pouvait s'apparenter à un topster 100 commenté, appelé Rap français - Une exploration en 100 albums.
Une décennie plus tard et après avoir traversé ce que beaucoup pourraient nommer le second âge d'or du rap français, le journaliste ne revient pas avec un nouveau top (format désuet, ne nous mentons pas #tierlist) mais avec ce que l’on pourrait qualifier de longue chronique de l’évolution du rap français des 30 dernières années. C’est d’ailleurs comme ça que l’éditeur décrit son nouveau livre Le rap a gagné en 4ème de couverture : “une chronique de l’explosion artistique qui a vu le rap s’imposer partout”.
Le livre se structure en deux parties :
- Une première partie découpée en 5 chapitres qui se veut historique et qui retrace l'évolution des esthétiques rap au cours du temps.
- Une deuxième partie découpée en 3 chapitres qui essaie d'analyser le changement de statut du rap en . C’est notamment cette partie qui se veut analyser la “popification” de cette musique.
Le monde étant manichéen et terriblement pressant (relire TH), je vous propose donc de commenter globalement les deux parties l'une après l'autre. Cela vous rappellera peut-être les commentaires de texte que vous aviez à rédiger pour votre prof de français concernant, à tout hasard, une scène horriblement chiante de la Princesse de Clèves.
Pas de panique cependant, ce que je vais écrire est de l'ordre du 11/20 et sera donc bâclé, vous assurant que je ne dée pas l'équivalent d'une copie double.
Le rap a gagné
La première partie se concentre donc sur l'évolution et l'importance de certaines esthétique dans le rap français, mentionnant pêle-mêle le rap marseillais, le rap alternatif, le boom bap ou encore Booba.
Si le choix des chapitres me semble cohérent au regard de ce que produit Mehdi Maizi, le sequencing de cet album me turlupine parfois.
Par exemple, le fameux chapitre concernant Booba. Déjà, rappelons que le journaliste et le rappeur sont en beef et que le principal concerné ne semble pas avoir très apprécié ce qu'on a écrit à propos de lui. Ce chapitre permet, certes, de comprendre (ou se rappeler, c’est selon) l’importance qu’il a eu dans ce paysage rap et surtout à quel point son esprit de “trendsetter originel” (p33) lui a permis de rester au dessus de la mêlée pendant toute sa carrière.
Mais il semble omettre toute une partie relative au côté businessman de Booba qui a pourtant, lui aussi, largement transformé le rap français. Je peine à comprendre, par exemple, pourquoi toute l’histoire du 92i n’est pas racontée plus en détails. Surtout la “seconde partie”, puisque Booba a produit énormément d’albums dont on parle encore aujourd’hui, notamment ceux de Damso et Shay. Il a d’ailleurs probablement encore acheté une maison secondaire avec l’argent d’Ipséité.
Damso est par exemple mentionné très rapidement dans ce chapitre avant de l’être de nouveau dans le chapitre “no borders, rap francophone et pop mondiale”. De même, l’histoire d’OKLM est très vite balayée du revers de la main alors qu’énormément de jeunes artistes émergents ont pu y er une tête.
Un autre exemple d’incompréhension sur ce fameux sequencing est l'absence de chapitre consacré à l'arrivée de la trap // drill en , même si la première est mentionnée en filigrane tout le long du livre. Est-ce que l'arrivée d'un sous-genre aussi majeur ne méritait pas plus que quelques évocations, surtout si l'on met en parallèle le chapitre entier consacré au renouveau du boom bap qui concerne finalement peu d’artistes actuels ?
Mais il est en réalité assez compliqué de commenter cette première partie une fois les quelques erreurs et angles morts mentionnés. La partie se veut globalement historique et même si elle peut être lacunaire à certains égards, ce ne sont au final que des choix. Certains lecteurs de Sens Critique auraient peut-être préféré qu’il parle encore plus du renouveau du boom bap et parle d’alpha wann pendant 50 pages. D’autres auraient peut-être voulu qu’il parle plus longuement d’autres influences qui ont inspiré le rap ces dix dernières années.
Je pense aussi que c’est en lisant cette première partie qu’on comprend que le livre ne sait parfois pas trop sur quel pied danser (il n’a pas de pieds, en effet !)
Il est parfois pointu, comme quand il décrit par exemple le boom bap rythmiquement et musicalement : “Musicalement, c’est le recours à des beats assez minimalistes ; c’est le break des morceaux disco ou de funk joués à 90 BPM ; ce sont des caisses claires très puissante (contrairement à Los Angeles qui a souvent utilisé le clap plutôt que la caisse claire) ; c’est le recours aux samples [...] de soul et de jazz, essentiellement” (p81).
Mais pour une raison que j’ignore, il a été écrit comme si c’était un script de vidéo Youtube : le langage choisi est très parlé et le bouquin est rempli d’anecdotes qui sont plus ou moins pertinentes selon le contexte. Si l’autocitation peut sembler parfois pertinente puisque Mehdi Maizi reste celui qui discute le plus avec les rappeurs, on peine parfois à comprendre d’autres anecdotes. Vous pourrez donc lire, par exemple : “Sur Mauvais Oeil, il parle de religion. Aujourd'hui la religion, sans vouloir spéculer sur sa vie, elle a l'air beaucoup moins présente dans des textes” (p42-43). On entendrait presque parfois sa voix émaner du livre et nous introduire un nouvel épisode du Code.
A quel prix ?
A mon sens, le sous titre de ce livre était tout aussi, si ce n'est plus, important que le titre.
Depuis quelques années, de nombreux débats entourent le microcosme qu’est le rap français, notamment quant à sa porosité avec des discours d’extrême droite, ses “”“industry plant”””, sa gentrification et ses cultures vultures. On voit également se cre de plus en plus cette fameuse dichotomie entre le rap street le rap de ienclis, quoi que cela veuille dire.
D’autres débats concernant l’esthétique sonore et visuelle gravitent aussi autour de ces débats mentionnés plus haut.
Si je suis globalement satisfait du chapitre concernant le streaming, les deux autres chapitres me semblent beaucoup plus fragiles.
Concernant le chapitre sur le streaming, son impact sur l’esthétique musicale et visuelle du rap est assez bien résumé : les morceaux raccourcissent et les projets s’allongent, les niches musicales se multiplient, Tiktok arrive à donner une carrière à n’importe quel morceau viral et le visuel prend une part plus importante qu’à l’époque (même s’il faut bien souligner la perte de vitesse phénoménale de YouTube ces dernières années qui est en train de tuer à petit feu le format clip tel qu’on le connaît). C’est concis et suffisamment clair pour que tout le monde puisse comprendre tout ce que ce modèle a pu avoir comme effets en une vingtaine de pages et il ne me semble pas qu’il y ait autre chose à commenter là dessus si ce n’est l’esthétique et le changement de rythme de consommation et de production, mentionné également dans ce chapitre.
Concernant les deux autres chapitres, je suis globalement moins enjoué puisqu’on arrive à la partie qui est censée commenter plus globalement les débats qui gravitent autour du rap français. Mon problème principal avec ces chapitres est globalement la superficialité avec laquelle elle aborde des sujets qui auraient dû être, à mes yeux, plus approfondis. Je ne dis pas cela sur un ton professoral mais il me semble qu’au vu de la position qu’à Mehdi Maizi au sein du rap français, une analyse de fond s'impose, encore plus quand on sait qu’il est édité chez La fabrique.
L'exemple de Freeze Corleone est à mon sens symptomatique de certaines analyses livrées par Mehdi Maizi dans son livre.
Concernant le glaçon, il est d'abord dit : "Un personnage comme Freeze Corleone soulève de nombreuses questions sur ce point (quant à sa complaisance face à une partie assumée RN de son public)" (p162).
Puis, plus tard : "A titre personnel, mais je peux me tromper, je suis persuadé que l'artiste n'a rien à voir avec l'extrême droite française. Néanmoins, le doute qu'il laisse subsister pose une vraie question sur son engagement et sa responsabilité vis-à-vis de son audience" (p162).
Sont fait aussi mention le fait qu’il a utilisé des dogwhistle et qu’il est edgelord.
Et... c'est tout.
Cela aurait mérité une analyse plus approfondie :
- Pourquoi ne pas avoir mentionné le fameux dogwhistle ? Je pense que tous les lecteurs auront compris qu’il est ici fait référence à l’épisode des “dragons célestes” et il me semble nécessaire de le citer afin de mieux contextualiser l’évocation du principe de dogwhistle.
- La fameuse seconde jeunesse que Freeze Corleone a offert au Roi Heenok aurait aussi mérité d’être analysée.Même si, à la décharge du M, le Roi ne faisait pas encore le tour des médias pour faire le trumpiste.
- Pourquoi ne pas avoir commenté le fameux épisode entre Universal et Freeze Corleone ? Pour ceux qui ne situent plus, Universal avait signé un contrat de distribution pour LMF et ces derniers se sont finalement rétractés quand les médias généralistes ont commencé à s’intéresser au rappeur. Que Freeze Corleone soit “ambigu” quant à l’antisémitisme dans ses textes est une chose mais peut-on aussi parler de la responsabilité d’une maison de disque dans la diffusion massive d’un discours qui est borderline ? Loin de moi l’idée de vouloir mettre tous les maux de cette terre sur le dos de Bolloré, mais….
- Je pense que la collaboration avec Django aurait pû être évoquée tant c’est un exemple en termes de musique edgelord mdr.
Ces ages montrent aussi que Mehdi Maizi, parfois, semble en train de marcher sur des œufs. Et même si l'on regrettera le age écourté concernant les accointances entre le nouveau public rap et l'extrême droite, on ne peut pas vraiment s'empêcher de se dire que vu la susceptibilité des rappeurs, parfois...
J’entends cette volonté d’être synthétique et de vouloir livrer un ouvrage condensé mais en ressort parfois un cruel manque d’analyse sur certains aspects.
J’ai ici mentionné rapidement ce qui me chiffonne avec l’évocation du cas de Freeze Corleone mais d’autres sujets malheureusement peu développés existent. Je peux citer en guise d’exemple l’évocation des “footixs” du rap (p166) et de leur obsession des chiffres qui tient sur une page, la récupération du rap et de son esthétique par la mode ou encore le désintérêt des auditeurs pour les racines du rap.
Je pense qu’en réalité, si Mehdi Maizi arrive à synthétiser correctement les changements esthétiques que l’on a pu voir arriver dans le rap, il synthétise en revanche trop son propos quand on en arrive aux questions concernant le racisme, l’antisémitisme ou l’économie du rap / des médias rap.
Je peine à comprendre comment on peut par exemple qualifier de “public un peu louche” (p171) le public de Freeze Corleone sans mentionner explicitement pourquoi il est justement “louche”. Je ne dis pas qu’il n’évoque jamais ces questions là puisqu’il est notamment fait mention de la Palestine et du concert caritatif de Tif (p181) ou du 11’30 contre les lois racistes et de No Pasaran (p160-161) mais qu’il les évoque trop succinctement.
De même quand on parle de l’entrée d’un nouveau public dans le rap “par un refrain de Josman, ou une mélodie de Damso” (p167), non initié. Ça mérite d’être développé.
Conclusion qui me vaudra 11/20
Ne nous voilons pas la face, Mehdi Maizi est à l’heure actuelle un interviewer et un animateur qui n’avait quasiment pas repris le stylo depuis 10 ans. Il aurait été ridicule d’attendre de sa part un pavé de 600 pages analysant en détail 30 ans de rap français de façon universitaire.
Je reste cependant déçu face à certains choix qui ont été faits, notamment quant à son registre de langue et à la deuxième partie mi-figue mi-raisin.
Je suis convaincu que le ton global du livre et son registre de langue sont en décalage total avec la volonté d’écrire une chronique rigoureuse et accentuent l’impression de manque d’analyse critique dans la seconde partie de l’ouvrage.
Je pense néanmoins que c’est ce choix de ton qui lui permettra de brasser suffisamment large et de toucher presque tous les publics, dont le fameux mentionné dans le livre : celui qui écoute énormément de rap sans pour autant y connaître grand chose.
C’est un livre qui reste intéressant pour des gens qui veulent situer globalement où en est le rap en 2025 mais pas pour les gens qui attendent plus.
Je serai malgré tout moins sévère que l'autre personne qui a écrit une critique sur ce livre : je ne souhaite à personne d'être comparé au vidéaste Le Potager, encore moins si c'est pour dire que je ne dis rien de plus intéressant que lui.