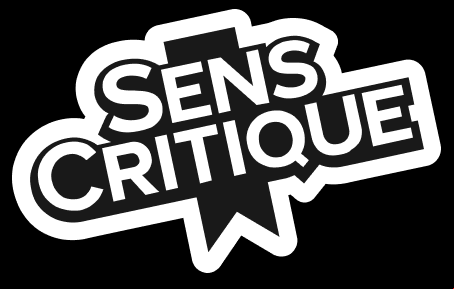Le paradoxe que Rousseau développe dans son « Discours sur les sciences et les arts » peut sembler disqualifiant quant à son crédit philosophique. En effet ce dernier, lors du concours d’éloquence de l’Académie de Dijon de 1750 portant sur la question de l’effet des sciences et des arts sur les mœurs, déclare solennellement qu’ils contribuent à les corrompre. Pour un philosophe ayant écrit des pièces de théâtre et ayant étudié les sciences toute sa jeunesse, c’est assez cocasse. A l’époque, cette argumentation d’une vingtaine de pages, remportant au age le prix du concours, eut l’effet d’une bombe à la crème au beau milieu d’une aristocratie intellectuelle qui s’insurgea avec force contre une telle provocation. Mais ce combat qui ressemble à celui d’un sophiste taré face à des dictateurs de la pensée trop contents de trouver dans leurs réfutations un moyen de se distraire de leurs vies luxueusement ennuyeuses dée-il son simple contexte historique ?
La lecture du discours laisse tout d’abord un peu circonspect tellement son contenu réflexif est à contre-courant des autres Lumières de son siècle, à commencer par Voltaire ou Montesquieu. Le pédant auteur de « Candide » avait d’ailleurs affirmé que si l’on écoutait Rousseau, on retournerait bientôt brouter de l’herbe dans les champs. Assurant que c’est lorsqu’Athènes et Rome adulèrent trop la philosophie qu’elles s’écroulèrent, pour mieux faire l’éloge de l’ignorance innocente et aveugle, il faut dire que Jean-Jacques déconcerte, même à notre époque. Fier d’être seul contre tous, Rousseau prit la peine de répondre à quelques-unes de ces réfutations (des lettres qui suivent le discours dans mon édition), la plupart du temps pour expliquer pourquoi il n’a pas besoin d’y répondre, s’engouffrant ainsi tête baissée dans un autre paradoxe. S’il assure que la médiocrité de ses détracteurs est trop grande pour être prise en compte, il n’en reprend pas moins leurs mots pour mieux se défendre. Jean-Jacques qui parle parfois de lui à la troisième personne joue alors indéniablement de son égo surdimensionné et de son immense talent de rhéteur pour botter l’arrière-train de ses adversaires intellectuels avec mille fois plus de subtilité que n’importe quel rappeur.
Mais c’est alors que sa plume particulièrement affutée qui semble gâcher son encre à des querelles de cour futiles éclaircit les zones d’ombres de son raisonnement, le nuance et fait peu à peu prendre consistance à sa thèse. Certes, son inclination à l’Eglise et la Bible m’agace profondément, là où un Kant avait la lucidité de s’insurger contre la religion et son institution. Quant à sa volonté de rejeter l’oisiveté à bloc pour glorifier l’éducation spartiate, elle me donne froid dans le dos. Mais il faut bien avouer que dans sa logique de démontrer la fausseté des conventions sociales, la cupidité des intellectuels comme des savants, il affronte une élite qui se délite avec force de pertinence. Il n’a pas l’idéalisme de croire que chaque individu est un De Vinci qui s’ignore, mais plutôt celui de croire en la bonté naturelle de l’homme. Seulement, le jour où l’un de ses représentants inventa l’idée de propriété privée et que d’autres furent assez fou pour le croire, s’ensuivit un mécanisme pervers qui engendra la société dans laquelle nous vivons. Rousseau, tout comme Socrate deux mille ans avant lui n’a rien contre les sciences et les arts en eux-mêmes, il les adule au contraire, mais n’en démontre pas moins leur nocivité dans le cadre d’une société libérale.
Après tout, n’est-ce pas la science qui entraîne notre planète vers une catastrophe écologique irrémédiable ? Chaque heure qui s’écoule voit Rousseau, à l’instar d’un de ses rares descendants idéologique Marx, se remuer dans sa tombe en constatant à quel point les tendances qu’il dénonçait se sont exacerbées. On ne peut nier que sa vision de l’état de nature de l’homme comme de la souveraineté démocratique qui « ne peut être représentée » sont des idéaux paraissant anachroniques, mais ce serait alors ettre le triomphe de l’élitisme. Rousseau, pas tant bouffi d’orgueil qu’il le laisse paraître (sa préface constate la médiocrité de son ouvrage, qu’il voit comme un avant-goût à son second discours, celui sur « l’origine et les fondements des inégalités parmi les hommes ») voit en l’émergence des idées de la Renaissance un moyen de laisser dans la fange une majorité d’esclaves. Pis, pour se dédouaner de toute domination et attester de sa prétendue vertu, qu’un tel individualisme ose l’hypocrisie de théoriser leur libération prochaine par la connaissance pour mieux empêcher sa mise en pratique. En entrevoyant la possibilité d’un altruisme, Rousseau n’était-il finalement pas le plus humaniste de son siècle ?