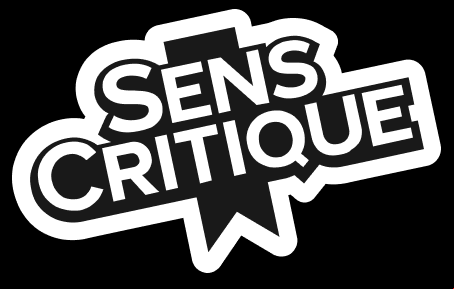En choisissant Lyon comme lieu d’égarements et de recompositions multiples, Emmanuel Mouret inscrit son geste dans la continuité du cinéma des origines – la ville des frères Lumière – tout en composant un film de fantômes dans lequel chaque personnage vit dans l’ombre d’un ou de plusieurs autres, louvoie entre différents foyers qu’il faut tantôt quitter tantôt louer tantôt projeter de ses rêves irréalisables. Voilà donc une déclinaison intelligente offerte à la filmographie d’un cinéaste explorant le badinage amoureux sous tous ses aspects, y compris ici ses plus tristes. La tonalité pathétique qui gouverne l’ensemble ne se vautre jamais dans le dolorisme complaisant, conjurée par une écriture rigoureuse de protagonistes disposant chacun d’une profondeur et, surtout, d’une bonté d’âme quels que soient les choix effectués. Ce refus du manichéisme est précieux, sonde l’humain dans ses paradoxes sans simplifier les histoires.
Il y aurait donc, chez Mouret, la tentation de se faire moraliste, mais un moraliste qui se serait affranchi de la religion et de toute idéologie prédéfinie, à la manière d’Éric Rohmer. À ce titre, la présentation en guise d’ouverture des endroits lyonnais que peupleront ensuite les personnages contribue à la posture de spectateur d’un moraliste soucieux de raccorder la société qu’il étudie à la nature humaine dans son atemporalité – des ruines antiques aux innovations urbaines en ant par le musée, espace où se rencontrent é et présent – et dans son universalité. Une réussite.