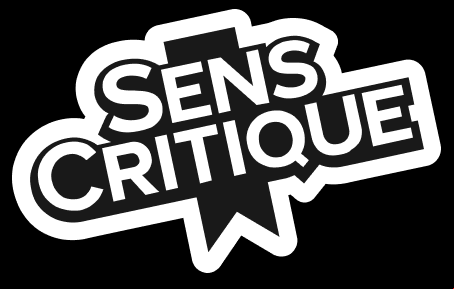Présenté en séance de clôture de la Semaine de la Critique, Planètes est une synthèse remarquable des techniques développées par Momoko Seto dans sa série de courts-métrages Planet – composée de Planet A, Planet Z, Planet ∑ et Planet ∞). C’est à la fois une œuvre visuelle et sensorielle d’une grande puissance, qui touche droit au cœur. Jamais auparavant nous n’avions vu des personnages végétaux aussi vivants, aussi émouvants. L’ambition de la réalisatrice est claire : « montrer que la nature est un acteur, et non un décor ».
Sans dialogues, à l’instar de Flow l’an é, Planètes construit sa narration exclusivement par l’image. Il en résulte une composition brillante mêlant prises de vue réelles et animation 3D. Le film nous invite à suivre le voyage de quatre akènes de pissenlit – ces petits fruits ailés – contraints de quitter leur planète, probablement la Terre, à la suite d’une catastrophe. À la recherche d’un sol fertile, propice à la survie de leur espèce, ces rescapés entament une odyssée cosmique, que la cinéaste elle-même compare à un « Indiana Jones végétal ». Et la comparaison n’est pas exagérée.
Un défi majeur se posait pourtant : comment insuffler de la vie et de l’émotion à des entités aussi peu expressives que des graines ? Et comment « fictionnaliser la nature » sans tomber dans l’artifice ? Là où certains diraient que c’est impossible, Seto démontre que la force de l’animation est directement proportionnelle à l’imagination. Chaque akène, bien que jamais nommé, se distingue par une personnalité propre, identifiable par des détails de morphologie : la forme de leur graine, la disposition de leurs aigrettes – ces fines touffes de poils blancs et plumeux. À mesure que l’on suit leur périple, on finit par les reconnaître, les encourager et s’y attacher. Ces akènes possèdent en outre une capacité de mouvement et de communication. Le travail de sound design, signé Nicolas Becker, contribue à cette illusion de vie. Il a su créer un langage universel et émotionnel, nous permettant de ressentir les états d’âme de ces minuscules voyageurs de l’espace.
Un autre tour de force du film réside dans ses décors, animés en time-lapse. Ce procédé compresse le temps pour rendre visibles des phénomènes imperceptibles à l’œil nu, et transforme la nature en spectacle vivant. L’intégration parfaite des akènes en 3D dans ces décors réels renforce la cohérence d’un univers en constante métamorphose. Leurs interactions avec la faune et la flore – des limaces rampantes, des têtards aériens, des champignons agressifs – participent à ce mélange fascinant de réel et de fantastique. Les prises de vue macroscopiques abolissent les frontières entre science et imaginaire, les plaçant sur un pied d’égalité.
La cinéaste va plus loin encore. Elle ne se contente pas d’un film contemplatif ou quasi-documentaire. Elle convoque les éléments dans toute leur brutalité : l’eau, le feu, la glace, mais aussi d’étranges textures spongieuses viennent se heurter aux héros végétaux. Les akènes affrontent ces forces primaires, car chaque écosystème traversé possède ses propres lois et sa propre logique de survie.
Il a fallu un an pour animer ces personnages, et plusieurs années pour composer cette symphonie d’images et de formes de vie microscopiques. Ce récit, humble et généreux, évoque Minuscule : La Vallée des fourmis perdues dans sa manière d’exalter la vie à une échelle invisible. On se laisse entraîner dans ce jeu de la survie, porté par la musique électrisante de Quentin Sirjacq, qui nous immerge dans une nature à la fois brutale, sublime et indomptable.
Mais au-delà de la performance technique et artistique, le film glisse progressivement vers une réflexion plus intime. Ce qui, au départ, ressemble au scénario d’un film catastrophe se mue en une fable sur la résilience de la nature et sa capacité à se régénérer. C’est aussi une histoire de déracinement, d’errance, puis de réenracinement, trois notions qui résonnent avec l’expérience personnelle de Momoko Seto, qui a vécu entre la culture Japon française depuis son enfance, avant de s’établir au CNRS. En ce sens, Planètes reflète son propre chemin.
Bien plus qu’un film d’animation expérimental ou un exercice formel autour de l’infiniment petit, Planètes s’impose comme une œuvre poétique, politique et contemporaine. Dans une époque marquée par l’urgence climatique et les fractures écologiques, Seto compose un récit sans mots mais non sans discours, où la fragilité du vivant dialogue avec sa ténacité. Ce film d’une rare beauté, à la croisée du film de science-fiction, du conte écologique et de la fable philosophique, invite à repenser notre regard sur ce qui nous entoure. Il nous rappelle avec douceur et force que la nature, aussi discrète soit-elle, lutte, persiste, et raconte sa propre histoire. Une œuvre mémorable.
Retrouvez toutes nos critiques du festival de Cannes 2025 sur Le Mag du Ciné.