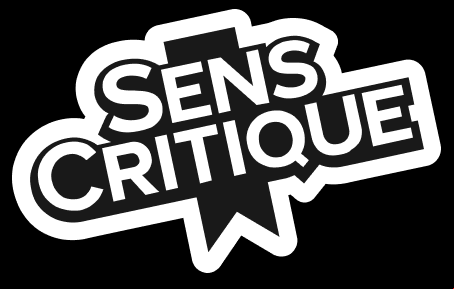Comédie musicale au titre faisant tout à la fois rêver, valser et fredonner, "My fair Lady" a marqué une époque et soulève des questions qui n'ont pas fini de traverser notre société.
Au coeur du film est l'enjeu du langage comme marqueur entre les classes et levier de mobilité sociale. Linguiste expert, le professeur Henry Higgins prend le pari, sur un coup de tête et par pur défi personnel, de rendre Eliza Doolittle, une pauvre fille vendant des fleurs dans la rue, une "fair Lady".
Le film transmet, de manière assez juste, l'élévation par le langage d'Eliza, qui gagne en émancipation et en maturité. De même, le changement de rapport de force entre maître et élève est plutôt bien mené.
Il faut dire que le potentiel d'évolution était grand, étant donné la représentation réduite et hermétique des deux classes sociales, à laquelle s'ajoute un ton franchement paternaliste et misogyne du professeur vis-à-vis de la marchande de fleurs.
Ainsi de la figure du père, brossée par le préjugé du travailleur pauvre qui ne veut pas travailler et préfère s'enivrer.
On préfère croire que cette représentation est à prendre au second degré et que le film utilise un ton ironique pour mieux se défaire des préjugés touchant les femmes et la classe populaire.
La comédie musicale, parce qu'elle enchante les mots du quotidien, apparaît comme la forme idoine pour illustrer le propos philosophique, sociologique et même politique du langage, comme clé de reconnaissance sociale.