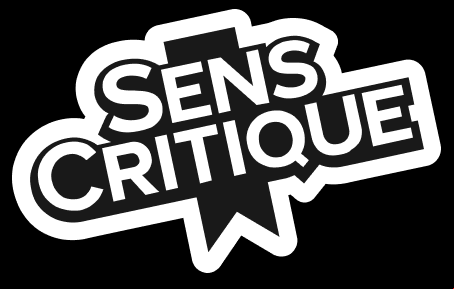Les chevaux de feu s’annonce comme un drame poétique : revisitant le mythe de Roméo et Juliette, lui-même un écho de la propre histoire de Serguei Paradjanov, il explore une multitude de dimensions, plastiques et thématiques, pour aboutir à une œuvre au statut hors norme.
Le récit des amants malheureux n’occupe qu’une partie du film, qui donne aussi à voir la vie des Goutzouls, une communauté des Carpates dans une Ukraine non datée, mais au contexte médiéval. Résolument ethnographique, le cinéaste qui a vécu longtemps avec ces gens s’attache avant tout à leurs rites et explore le folklore éclatant du culte orthodoxe (non sans lui addre quelques extrapolations imaginaires) : coloré, costumé, festif, collectif, mouvementé. Tout le film est traversé par les danses et les rites, dans une atmosphère fébrile, soulignée par une musique traditionnelle constante, parfois presque oppressante, dont l’usage nous rappelle la bande son de Klimov dans Requiem pour un massacre.
L’imagerie, l’iconicité semble ici balayer tout autre mode d’expression : les dialogues sont rares et s’effacent derrière les chansons ou les cartons, qui scindent le film en 12 parties, à la manière d’un calendrier, assimilant encore davantage l’œuvre à un livre d’heures. Chaque saison, chaque fête est la chair même de ce récit.
Paradjanov n’en délaisse pas pour autant l’émotion et la beauté, tout d’abord pas l’exploration qu’il fait de la nature. Les jeunes enfants fusionnant avec la forêt dans un amour édénique (motif lui aussi exploité par Klimov dans la première partie de son film) illustrent un rapport harmonieux avec des paysages escarpés et magiques. Le bestiaire, la lumière, la matière même des éléments (l’eau, le feu, le vent, le bois) sont le fruit d’un travail obsessionnel et fascinant, à l’image de ces prises de vues sous-marines offrant le visage d’Ivan depuis la surface. La pluie dans la maison des bergers ou les courses dans les arbres évoquent bien entendu les motifs de Tarkovski, dont l’Enfance d’Ivan vient de sortir deux ans plus tôt.
Sur ce folklore se greffe donc une épaisseur sensitive et mystique que vient souligner l’amour universel des amants maudits. Cette ion dévorante motive le rythme du film, affolant et échevelé, ponctué par l’amour et la mort.
Ne reculant devant aucune expérimentation formaliste, Paradjanov multiplie les effets visuels. La caméra s’envole, virevolte en travellings latéraux interminables, traverse les bois, est éclaboussée de sang, et offre le spectacle d’une humanité vertigineuse, en mouvement constant. Les prises de vues obliques ou en contre plongée modifient le regard sur ces âmes tourmentées, ainsi que sur le décor disproportionné : les toits de bois, les ravins, les arbres en feu, tout semble habité par une dimension légendaire, voire mythologique.
La succession de tableaux colorés la violence iconique de son film, visent à nous impressionner comme le seraient les enfants à l’écoute d’un conte ancestral un soir de veillée : les yeux écarquillés, buvant ce récit universel d’amour, de mort et de foi.
Cet utilisateur l'a également mis dans ses coups de cœur et l'a ajouté à ses listes Les Tops de Dan