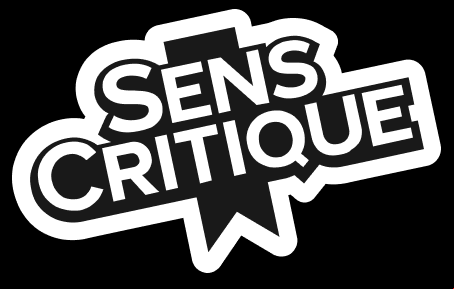Le concept a du bon : sur le canevas éprouvé de l’usage, qui définit à quoi devrait ressembler un film conventionnel, les expériences à la marge sont toujours fertiles. L’idée d’un film dénué de dialogues n’est d’ailleurs pas une chose foncièrement nouvelle lorsque Scola s’y attelle en 1983. Tati a déjà largement expérimenté ce parti-pris, ou Shindo dans L’île nue, par exemple, l’occasion, à chaque fois, d’une réflexion sur la condition humaine portée à une dimension universelle, dans laquelle chaque individu rejouerait une partition incontournable, à la fois attachante et ridiculement prévisible.
La salle de bal devient ainsi le terreau de cette nouvelle exploration des rapports humains. Le temps du divertissement, où on pourrait être soi-même et se laisser aller au plaisir du mouvement, mais aussi le lieu de la séduction où il s’agira, une nouvelle fois, de jouer un rôle. Marivaudage averbal, le bal est le lieu des parades, des résistances et des regards en coins, des rivalités et, pour les exclus, d’une solitude d’autant plus cruelle qu’elle se subit au regard de la collectivité.
Sur ce dispositif qui pourrait nourrir un court métrage, Scola greffe une dimension temporelle qui va explorer la même salle au fil de différentes époques, du Front Populaire à l’Occupation, du flon flon musette à la disco. Une salle, plusieurs ambiances. Si le renouveau est permis, les explorations sont néanmoins les mêmes, le même groupe de comédiens rejouant, à quelques variations près, la même comédie.
La question se pose assez rapidement : qu’est-ce que le cinéma vient investir dans cette unité de lieu et ce jeu forcément et sciemment outré de la pantomime ? quel est son apport, en quoi son esthétique et son propos vont-ils servir un dispositif résolument scénique, et d’ailleurs adapté d’un spectacle vivant ?
Si l’on peut saluer le travail de mise en scène qui permet d’investir l’espace et de jouer de toutes les mouvements pour accompagner la chorégraphie des silhouettes, la machine tourne tout de même rapidement à vide. Le concept est emballé en 20 minutes, et les 90 qui restent semblent vraiment interminables, ne devant leur renouvellement qu’à une bande sonore qui tente la plus grande diversité, et des ressorts assez laborieux pour dire des époques (les étudiants qui se réfugient, le flic qui tabasse un arabe, le nazi qui force une danseuse, etc.). Comme s’il fallait prouver que l’idée tient, et qu’elle permet effectivement de raconter le siècle. Comme si la finalité du film était moins une réflexion sur la nature humaine qu’un défi esthétique, l’exploration d’une contrainte qui révélerait le talent de celui qui sait l’essorer jusqu’au bout.