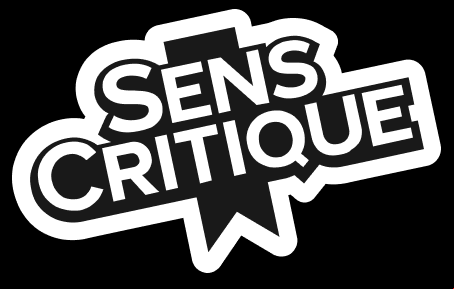Au carrefour du superbe « Chemin de croix » (2014), de Dietrich Brüggemann, pour le mysticisme violent d’un être encore adolescent ou tout jeune adulte, dans l’Europe actuelle, et de « La Prière » (2018) de Cédric Kahn, pour la découverte du sentiment religieux chez un ancien délinquant, se trouve l’impressionnante réalisation d’un jeune réalisateur polonais encore inconnu du grand public, Jan Komasa, alors qu’il signe ici son troisième long-métrage de fiction.
Daniel, âgé de vingt ans, achève de purger sa peine dans un centre de détention et de rééducation où il a été formé à la menuiserie. Son mysticisme personnel et sa fascination pour l’aumônier de la prison, le Père Tomasz (Lukasz Simlat), lui font désirer d’accéder à la prêtrise, mais le crime qu’il a commis, encore mineur, lui barre définitivement l’accès au séminaire. Alors qu’il se destine sans enthousiasme à un emploi d’ouvrier dans une petite ville de province, un concours de circonstances doublé d’un malentendu l’amène à remplacer, d’abord brièvement puis durablement, le curé de la paroisse (Zdzislaw Wardejn). Se faisant à son tour appeler « Père Tomasz », « Thomas l’imposteur » (pour paraphraser Cocteau) réveille par ses prêches vibrants la bourgade endormie, tout en œuvrant, par son empathie sincère, à la cicatrisation d’une plaie profonde.
Les thématiques abordées, les problématiques soulevées sont si nombreuses et si subtilement entrecroisées, à l’image du réel, que l’on sait d’emblée que l’on ne pourrait les recenser toutes, tant elles sont foisonnantes et corrélées à l’angle d’attaque. Sans doute cette abondance sémantique est-elle permise par l’excellence de l’interprétation, du tout premier rôle à la couronne de ceux qui l’entourent.
Bartosz Bielenia est ce Daniel, alias Père Tomasz, autour duquel l’imposture prend corps. Regard bleu ardent, visage aux traits délicats, presque un peu féminins, à la manière d’August Diehl, révélé à la connaissance d’un public autre que germanophile par le dernier Terrence Malick, « Une Vie cachée » (2019) ; mais avec une forme de rudesse ou d’âpreté qui pourrait rappeler Anders Danielsen Lie, découvert dans le bouleversant « Oslo, 31 août » (2011), de Joachim Trier. Une montagne d’ambivalence, pouvant exprimer aussi bien l’élan vers un Dieu intransigeant et vers une forme de pureté que des pulsions plus sauvages, voire violentes, s’éveillant en danses barbares au de certaines musiques ou transparaissant même avec fugacité dans certains gestes de messe. On ne sait quelle est la part de la direction d’acteur, confondante d’intelligence et de subtilité, et de l’inspiration personnelle dans le jeu, mais le savant mélange des deux force l’iration à de multiples reprises. Cette incarnation du personnage de Daniel pose à elle seule tout le problème de la foi : qu’est-ce exactement que la foi ? Trouve-t-elle sa source dans l’individu seul ? Emane-t-elle de plus haut ? Qu’est-ce qu’un bon prêtre ? Le jeune Daniel, dans l’écoute et l’attention qu’il accorde, offre parfois le silence d’un psychanalyste... Où e alors la différence : prêtre, psychanalyste, gourou, thaumaturge ? Peut-on toujours parler d’imposture, lorsque l’effet thérapeutique sur l’autre est indéniable ? On mesure combien le questionnement soulevé par cette réalisation, sur un scénario de Mateusz Pacewicz, croise de nombreuses interrogations encore irrésolues dans nos sociétés actuelles.
Troublante également, la manière dont, avec une grande économie de moyens, la caméra de Piotr Sobocinski Jr parvient, en des tons gris bleu tournés vers le spirituel, à faire entrer de plain pied dans la problématique mystique du personnage principal. Généralement fixe, sauf exception commandée par l’action et prenant alors tout son sens, la caméra ne pétrifie pas son cadrage comme dans « Chemin de croix » et s’autorise des mouvements d’objectifs qui animent le plan, à la manière d’une attention se centrant sur son objet, et en font exploser toute la déchirante humanité. À d’autres moments, se faisant presque photographique, et cadrant des fenêtres dans d’humbles parois de bois flanquées d’images pieuses, elle fait affleurer la profonde religiosité d’un lieu, si modeste soit-il.
Comment vivre avec le deuil ? au-delà du deuil ? Qu’en est-il de la rancoeur ? de l’expiation ? du pardon ? Qu’est-ce qu’être bon Chrétien ? Qu’en est-il du célibat des prêtres ? L’amour peut-il être interdit à une profession, sous prétexte de vocation ? Autant de questionnements plus latéralement, mais non moins urgemment, soulevés.
À travers l’accompagnement d’une trajectoire éminemment individuelle, celle, sur quelques semaines, d’un personnage en-dehors du troupeau paisible des humains et ne sachant occuper que la marge mais ant d’un extrême à l’autre, d’exclu à élu, le spectateur ressort ainsi gorgé d’interrogations, non seulement sur un parcours au bout du compte solitaire, mais sur la signification et la nature de ce qu’il est convenu de nommer la vie en société et sur sa prétendue « communion » : une société n’est-elle pas bâtie sur autant de désagrégation que d’agrégation, autant d’exclusion que d’inclusion ?