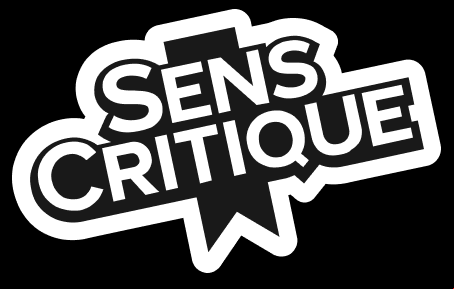Dans l’espace, des spores migrent vers la Terre. Arrivées sur notre planète, elles profitent de la pluie pour retomber, à l’insu de tous, sur San Francisco. Elizabeth Driscoll (Brooke Addams) est une scientifique du ministère de la santé. En quelques jours, elle observe un changement inhabituel chez son compagnon. Dénué d’émotions, celui-ci semble ne plus être la même personne. Elle partage son inquiétude avec son ami proche Matthew Bennell (Donald Sutherland), un inspecteur des services de l’hygiène. Celui-ci la présente au docteur Kibner (Leonard Nimoy) qui lui explique que, selon lui, son impression est due au fait qu’elle souhaite rompre sans pouvoir y parvenir. Entretemps, Matthew et ses amis Jack (Jeff Goldblum) et Nancy Bellicec (Veronica Cartwright) vont eux aussi être témoins de l’impensable, alors que de plus en plus de gens affirment ne pas reconnaitre leurs proches. Il semble que certaines personnes ont été remplacées par leur double durant leur sommeil.
Adapté du roman The Body snatchers (1955) de Jack Finney, L’Invasion des profanateurs de sépultures (1956) de Don Siegel, aura marqué son temps par sa vision glaçante d’une invasion extra-terrestre insidieuse, à rebours d’une Guerre des mondes tapageuse, et par son propos anti-communiste. Sorti plus de vingt ans après, en 1978, son premier remake, L’Invasion des profanateurs, bien que mésestimé en son temps (le film fit un four en salles), reste aujourd’hui un grand classique de la SF paranoïaque, en plus d’un parfait exemple de remake réussi.
Réalisé par Philip Kaufman (à qui l’on doit L’Étoffe des héros ainsi que l’essentiel du script des Aventuriers de l’Arche perdue) et scénarisé par W.D Richter (Les Aventures de Buckaroo Banzaï à travers la 8ème dimension, Jack Burton dans les griffes du Mandarin), L’Invasion des profanateurs aura peut-être pâtit à son époque du succès des spectacles grandioses qu’étaient Star Wars et Rencontres du troisième type (tous deux sortis en 1977), mais s’inscrit pourtant parfaitement dans la veine du cinéma paranoïaque de cette décennie qui, suite notamment au scandale du Watergate, aura vu la sortie de plusieurs grands thrillers politiques aux propos désillusionnés et subversifs (À cause d’un assassinat, Capricorn One, Les trois jours du Condor, Marathon man). À savoir que son intrigue sur une invasion extra-terrestre "silencieuse" cache en fait un sous-texte plus corrosif, dénonçant une Amérique des apparences où chacun perd progressivement son individualité. Un propos qui faisait parfaitement écho aux troubles socio-politiques de l’époque.
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Kaufman situe son intrigue à San Francisco. Pendant de nombreuses décennies, la métropole californienne aura symbolisé l’avant-garde des communautés activistes, artistiques et libertaires. Ici, elle offre un contexte plus ample à l’invasion, son cadre urbain et surpeuplé extrapolant à merveille le microcosme rural du film original.
Pour autant, le film suit à peu près le même schéma narratif que l’original, à quelques variations près, notamment au niveau de la place des protagonistes dans ce nouveau contexte. On retrouve néanmoins au centre des enjeux, une histoire d’amour significative : celle de Matthew Bennell et Elizabeth Driscoll (qui ont les mêmes noms que le couple du film original), deux personnages qui s’aiment sans pouvoir se l’avouer. Principaux référents du spectateur, Matthew et Elizabeth se montrent différents des autres personnages du film (le docteur Kibner, le petit ami Geoffrey, l’écrivain Jack Kellicec et son épouse Nancy), lesquels révèlent tous des failles narcissiques évidentes dans une ville où le besoin de reconnaissance et la contre-culture est reine. Si certains d’entre eux sont parmi les premiers à être convertis, leur sort apparait ironiquement comme un chatiment adapté à leur ego : tous soucieux de leur image et exprimant chacun une façon de pensée qu’ils estiment aussi singulière que brillante (voir les personnages de David Kibner et de Jack Bellicec, deux auteurs, l’un connaissant le succès, l’autre pas, mais aussi égocentriques l’un que l’autre) vont voir leur individualité dissoute dans une seule et même identité de masse, celle des envahisseurs. En cela, les doubles dénués d’émotions du film peuvent toujours se voir comme une métaphore du communisme, comme dans le premier film. Mais fin des 70's et cadre californien oblige, le propos de ce remake s’adapte à son époque pour devenir aussi plus subtil : le danger de cette Amérique-là, danger dénoncé dans d’autres films de l’époque, est celui de la manipulation politique et du contrôle de l’opinion publique. Les esprits les plus "libres" et brillants en viennent finalement à suivre le courant en ne remettant plus rien en cause dans ce que devient leur pays. Le film tout entier est une mise en garde sur les dangers du consensus et de la non-remise en question. En cela, Kaufman exprime par une idée forte l’ostracisation et la mise à l’index des esprits rebelles : lorsque les doubles repèrent un humain non converti parmi eux, ils le pointent du doigt avant que leur visage ne se déforme dans un cri horrible et inhumain (beau boulot de Ben Burtt sur les bruitages) censé attiré l’attention des autres sur la présence de l’intrus (John Carpenter en inversera d’ailleurs l’idée dans une séquence culte de The Thing).
Dans cette optique, les cinq dernières minutes du film se révèlent si glaçantes, qu’on les croirait toutes droit sortie d’un livre de Richard Matheson. On suit un des protagonistes du film tandis que la caméra s’attarde sur ses errances et le regard qu’il porte sur la société humaine qui a changé autour de lui. On s’interroge sur son humanité alors que sous ses yeux des enfants plein de vie et inconscients du danger sont conduits au cinéma pour y être assimilés, triste écho aux camps de la mort des nazis. La dernière séquence du film, particulièrement marquante, reste parmi les plus mémorables de la science-fiction paranoïaque, avec celle concluant The Thing, et s’oppose à la fin ouverte du film original et au happy end du roman de Jack Finney par sa puissance d’évocation apocalyptique.
Véritable chef d’oeuvre du film d’invasion alien, bourré d’images dérangeantes (le chien à visage humain), et parfait exemple du remake surant l’original (on notera d’ailleurs le caméo de Don Siegel vers la fin du film), L’Invasion des profanateurs était probablement trop sombre et désespéré pour pouvoir rencontrer le succès en son temps. De même que The Thing, sorti quatre ans plus tard, c’est surtout durant les deux décennies suivantes qu’il acquit son statut de film culte. Un classique qui, non seulement commente son époque, mais s’adresse aussi toujours à la notre, à l’heure d’une tendance à la formatation des esprits par les politiques, les influenceurs et tous les prétendus détenteurs de vérité, et de l’hyper-narcissisme induit par l’omni-présence de l’image et des réseaux sociaux. De quoi revoir ce bijou de SF noire sous un angle résolument plus moderne.