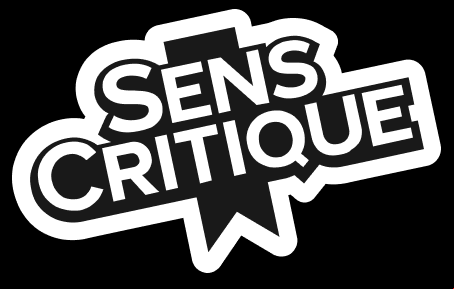Les romans de Georges Simenon choisis par Pierre Granier-Deferre pour adaptations partagent tous un protagoniste ambigu entretenant, par le détour de la conversation quotidienne au sein d’un cadre populaire, une relation souterraine avec une femme qui s’efface ou doit s’effacer au profit des autres. En cela, la marginalité criminelle de l’homme coïncide avec la marginalité sociale de la femme, tous deux trouvant dans l’autre une âme sœur qu’invalident leur entourage d’abord puis les forces de police enfin. L’Étoile du Nord fait se rencontrer deux personnages et, par la même occasion, deux espaces reliés par les transports en commun (bateau, train, tramway, bus) : l’Égypte d’un côté, riche d’une histoire millénaire sur laquelle plane d’ailleurs la suspicion du faux, de la copie, de la publicité pour touristes – en témoignent la bague et la réflexion tenue par l’un des convives au sujet d’une photographie rapportée par Édouard Binet – et de l’autre côté la banlieue ouvrière de Charleroi, définie par sa rue séparant deux rangées de maisons de briques rouges, sans histoire, sans photographie.
La projection d’un aventurier dans ce dernier cadre produit un effet exotique : la mise en scène veille ainsi à d’abord retarder l’apparition de la propriétaire de la pension, volontiers revêche, pour mieux ensuite la déplacer dans des lieux jusqu’alors étrangers, en particulier la chambre de Binet située au rez-de-chaussée. La perturbation engendrée par leur relation naît avant tout dans le foyer domestique, c’est-à-dire qu’elle est remarquée des pensionnaires justement parce que celle qui n’existait que pour eux commence à exister pour elle-même. L’originalité tient au refus du triangle amoureux au profit du véritable attachement qui rassemble Binet et Baron dont on ne connaîtra le prénom qu’en clausule, comme aveu d’un amour jamais formulé. Ces amants interdits bénéficient de l’interprétation subtile de Simone Signoret et de celle, à la truculence mêlée de louvoiements intérieurs, de Philippe Noiret. Une réussite.